 Titre : Aquarium
Titre : Aquarium
Auteur : David Vann
Éditions : Gallmeister Nature writing (2016) / Gallmeister Totem (2018)
Édition Originale : Aquarium (2015)
Traduction : Laura Derajinski
Résumé :
Caitlin, douze ans, habite avec sa mère dans un modeste appartement d’une banlieue de Seattle.
Afin d’échapper à la solitude et à la grisaille de sa vie quotidienne, chaque jour, après l’école, elle court à l’aquarium pour se plonger dans les profondeurs du monde marin qui la fascine.
Là, elle rencontre un vieil homme qui semble partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu son confident.
Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa mère découvre cette amitié et lui révèle le terrible secret qui les lie toutes deux à cet homme.
 Critique :
Critique :
Regarder des poissons nager, c’est reposant, déstressant, ça vous rend calme et contemplatif.
Caitlin, 12 ans, est un petit poisson qui vit seule avec sa maman, Sheri, qui fait de son mieux pour que sa fille ne manque de rien. Attendrissant.
Et puis, vous découvrez l’environnement merdique de certains poissons de l’aquarium, ceux que l’on appellera les « Poor White » et qui sont obligé de bosser comme des fous pour que des gros requins aux dents qui rayent le plancher s’enrichissent encore plus.
Pardon, pour qu’ils s’engraissent encore plus. Le monde la la jungle existe aussi dans le monde du silence qui n’a jamais si bien porté son nom puisque c’est marche (en fermant ta gueule) ou va voir ailleurs si l’eau n’y est pas plus douce.
Maman poisson Sheri est touchante, aimant sa fille, trimant comme une dingue, bref, elle force le respect.
Et puis, dans cet aquarium de Seattle où tout semble se dérouler normalement, arrive un vieux poisson tout ridé qui prend Catlin en amitié, lui parle et se laisse guider par la gamine dans ce monde de verre et de flotte, sans que maman poisson ne le sache.
L’aquarium était calme, tout allait bien, puis tout à coup, la tempête s’est déclenchée et la houle m’a emportée, retournée, j’ai bu la tasse devant les remous sauvages, violents que le poisson Sheri va déclencher.
Psychologiquement parlant, quand la tempête arrive, c’est difficile de rester de marbre face à déferlante de haine que Sheri va envoyer à sa fille, qui n’aidera en rien en campant sur ses positions. Il est des passages qui sont fort dérangeants et d’autres que j’ai passé, supporter une ligne de plus.
Après la tempête, un peu de calme, avant que la mère ne se déchaîne à nouveau, persifle et morde…
Certains passages de ce roman sont très doux alors que d’autres sont horribles, angoissants, trop violents. Les secrets de famille ne doivent pas être cachés, ils doivent être dit à temps car ensuite, c’est trop tard et les dégâts sont considérables.
La colère et la rage de la mère Sheri sont compréhensibles, pardonnables et l’entêtement de Catlin, petit poisson de 12 ans, ne voit que son nombril, pour elle, le monde tourne autour d’elle et butée, elle refuse d’ouvrir les yeux et de comprendre ce que lui explique sa mère.
Si Sheri avait tout ma sympathie, ensuite, elle est devenue imbuvable et est allée trop loin pour moi. À ce moment-là, l’entêtement de Catlin est devenu de la résistance et elle a forcé mon respect, même s’il était plu facile pour elle d’accepter ce traitement car elle savait qu’il ne durerait pas.
Aquarium commence doucement, dans une atmosphère feutrée avant que l’explosion n’ait lieu et ne chamboule les lecteurs.
Un roman psychologique sur le pardon, la rédemption, le courage et l’abnégation d’une mère, sur la couardise et l’absence d’un père, sur les poissons, sur le travail éreintant d’une femme, sur l’adolescence qui commence, les premiers amours, les secrets de famille et les relations familiales compliquées (euphémisme).
Mon seul bémol sera pour le fait que les guillemets et les tirets cadratins soient parti en vacances. Je déteste leur absence, elle me manque toujours cruellement et j’ai failli ne pas lire ce roman à cause de ça. Pour le coup, cela aurait été une erreur épouvantable.

Challenge Thrillers et Polars de Sharon (du 11 Juillet 2020 au 11 Juillet 2021) [Lecture N°XX].



 Titre : L’insigne rouge du courage
Titre : L’insigne rouge du courage Critique :
Critique :


 Titre : Arrive un vagabond
Titre : Arrive un vagabond Critique :
Critique : 

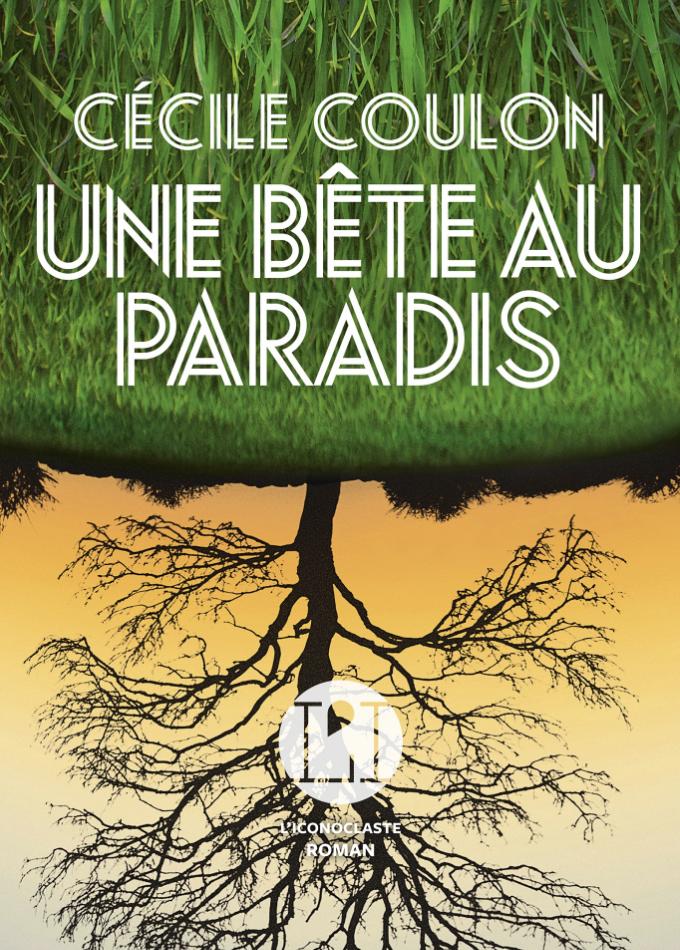
 Critique :
Critique : 


 Critique :
Critique :


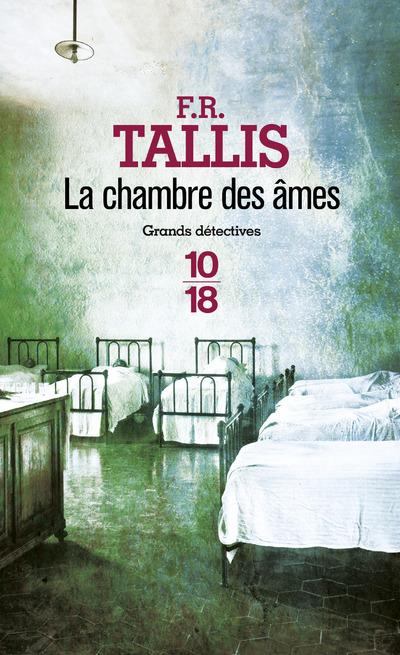
 Critique :
Critique :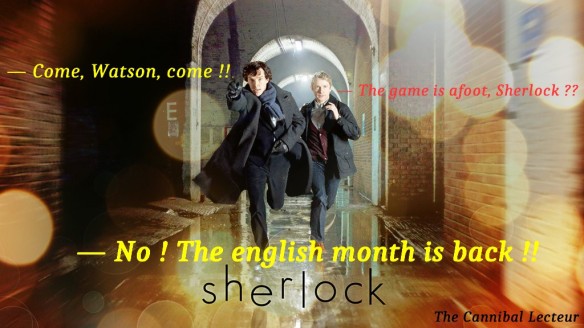



 Critique :
Critique : 


 Critique :
Critique :



 Critique :
Critique :




