 Titre : L’insigne rouge du courage
Titre : L’insigne rouge du courage
Auteur : Stephen Crane
Édition : Gallmeister Totem (07/11/2019)
Édition Originale : The Red Badge of Courage (1895)
Traduction : Pierre Bondil et Johanne Le Ray
Résumé :
Jeune garçon de ferme, Flemming vit la guerre de Sécession sous forme de nouvelles et de comptes rendus héroïques de batailles.
La guerre arrive au pas de sa porte, il finit par être entraîné dans son tourbillon et s’engage. Commence alors l’apprentissage du métier de soldat, l’école du courage.
Flemming est d’abord harcelé par le doute : sera-t-il capable de faire face, dans sa première bataille, sans déserter ? L’épreuve du feu débute par un échec total de notre héros : il cède à la panique et se retrouve fuyant parmi un groupe de déserteurs.
Suit alors une descente aux enfers où il vit une complète humiliation. C’est un parcours initiatique terrible, d’une vraisemblance rare et vraiment novatrice dans la littérature classique – excepté le panorama grandiose de la bataille de Waterloo vu par le jeune Fabrice dans La Chartreuse de Parme, d’où le héros, comme Flemming, sort désabusé quant à l’héroïsme des batailles. C’est en traversant cet enfer qu’il reprend courage et surmonte ses peurs…
 Critique :
Critique :
♫ À 18 ans, j’ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la guerre… ♪
Le coeur léger et gonflé de fierté, Henry Fleming s’engage dans l’armée de l’Union, sans écouter sa mère qui lui déconseille d’aller à la guerre.
Il se sent un héros, on l’adule, les gens fêtent le passage de ces jeunes soldats… Vu ainsi, ça a l’air vachement chouette, la guerre.
Mais on déchante vite car soit on est dans l’inactivité comme le sera Henry avec son régiment, soit on monte au front et là, on chie dans son froc.
Écrit 30 ans après la fin de la guerre de Sécession, ce petit roman se veut plus un récit sur l’inutilité de la guerre, sur son imbécillité, sur sa cruauté, sur l’héroïsme imbécile qui veut que les gradés souhaitent de belles charges, se foutant bien que tout le régiment trépasse sous le feu de l’ennemi, faisant monter les hommes à l’assaut inutile, juste pour grappiller 20 cm de plus.
Dans un conflit, on affronte plusieurs ennemis : ceux qui se trouvent en face, sois-même (sa conscience) et la Nature qui peut soit vous aider à vous cacher, soit ralentir votre fuite. Les ennemis sont nombreux et les pire ne sont pas toujours ceux d’en face.
Henry Flemming est comme bien d’autres qui s’engagent sous les drapeaux : après l’euphorie vient la peur, la trouille et la pétoche. Devant l’ennemi, on fuit et, courant dans le sens inverse de l’affrontement, on se demande ce qu’on est venu faire dans cette galère.
L’auteur n’a pas concentré son récit sur des affrontements mais plus sur la vie simple d’un régiment dans l’attente de la montée au front et dans les angoisses qui les étreint tous, mais que personne n’avouera. Tout le monde gamberge pour occuper le temps mort avant l’assaut.
Le récit est intelligent car il ne nous plonge que peu de temps dans l’horreur d’une bataille, préférant s’attarder sur les pensées du jeune Flemming et sur enthousiasme su départ qui, petit à petit, va disparaître une fois qu’il comprendra que tout cela n’est pas un jeu. Ses idéaux vont voler en éclats…
Le parcours du soldat Flemming est celui d’un bleu qui affrontera ses peurs, tout comme les jeunes qui composent son régiment. Dans sa tête, ça bouillonne d’émotions, ça cogite et nous verrons la bataille au travers de ses yeux.
Il m’a manqué des émotions, dans ce roman de guerre (roman psychologique ?) car à force de nommer notre narrateur « le jeune », je me suis détachée de lui et je n’ai pas su m’immerger pleinement dans ses déboires.
Ce roman est excellent dans sa manière de nous parler de la guerre de Sécession, de nous montrer tout l’inutilité de cette guerre fratricide, de sa boucherie, de son inhumanité, mais comme je n’ai pas su m’attacher au jeune Flemming, j’ai loupé une partie du récit puisque je n’ai pas vraiment ressenti d’émotions fortes.

Le Mois Américain – Septembre 2020 – Chez Titine et sur Fesse Bouc.





 Critique :
Critique :




 Critique :
Critique : 



 Critique
Critique
 Critique :
Critique : 
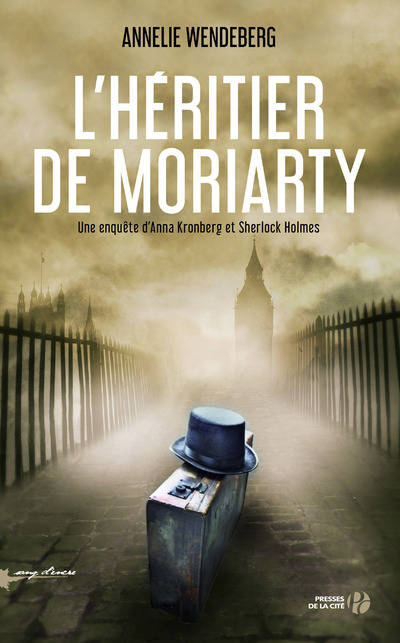
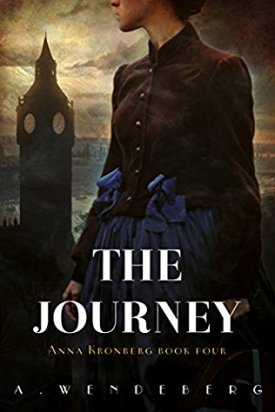 Critique :
Critique : 



 Critique :
Critique :
 Critique :
Critique : 

 Critique :
Critique : 


 Critique :
Critique : 
