 Titre : Les Dernières heures
Titre : Les Dernières heures
Auteur : Minette Walters
Édition : Pocket (28/04/2021) – 752 pages
Édition Originale : The Last Hours (2017)
Traduction : Odile Demange
Résumé :
Mois de juin de l’an 1348 : une épidémie monstrueuse s’abat sur le Dorset et décime peu à peu les habitants. Nobles et serfs meurent par milliers dans d’atroces souffrances.
Quand la pestilence frappe Develish, Lady Anne a l’audace de nommer un esclave comme régisseur. Ensemble, ils décident de mettre le domaine en quarantaine pour le protéger.
Bientôt, les stocks de vivres s’amenuisent et des tensions montent car l’isolement s’éternise. Les villageois craignent pour leur sécurité lorsqu’un événement terrible menace le fragile équilibre.
Les gens de Develish sont en vie, mais pour combien de temps encore ? Et que decouvriront-ils quand le temps sera venu pour eux de passer les douves ?
 Critique :
Critique :
♫ Confinés ♪ On était tout le monde confiné ♪ À voir nos existences s’arrêter ♪ À s’emmerder en se demandant pourquoi ♪ La peste est là ♪
♫ Confinés ♪ Inutile de fuir ou de lutter ♪ C’est écrit dans notre destinée ♪ Vous ne pourrez pas y échapper ♫ C’est gravé… ♪
♪ L’avenir ♪ Malgré nous est totalement plombé ♪ Tous nos désirs de liberté inespérés ♪ Limités, terminés ♫ (*)
Angleterre, 1348… La peste vient de faire une entrée remarquée, exterminant des populations entières dans des petits villages, n’épargnant ni les riches, ni les serfs.
Les conditions d’hygiène de l’époque étaient déplorables, puisque l’on vidait les pots de chambre dans des ruisseaux, sur le seuil de sa maison, que l’on déféquait dans les champs ou que l’on se soulageait là où l’on se trouvait.
Pourtant, à Develish, on est un peu plus propre qu’ailleurs, un peu plus intelligent aussi, plus éveillés, tout ça grâce aux conseils éclairés de Lady Anne. C’est d’ailleurs d’elle que va émaner l’ordre de se retrancher sur le domaine et de n’y laisser entrer quiconque.
Ça vous dirait un p’tit confinement de derrière les fagots ? De voir comment ça se déroule, lorsqu’on ne peut sortir du domaine où l’on s’est retranché ? Et qu’en 1348, Netflix n’existait pas, l’Internet non plus, la télé encore moins, la littérature était pauvre et réservée à ceux qui savaient lire (ils sont peu nombreux), pas de tuto sur You Tube pour apprendre la zumba, la guitare sans peine ou le macramé.
En 1348, pas question de se tourner les pouces, il faut consolider les murs, creuser des latrines, surveiller les réserves de bouffe parce que le supermarché du coin n’a pas encore été inventé. Faudra aussi occuper ses serfs, une fois que le boulot sera terminé et qu’ils ne pourront, aux champs, retourner.
Je ne suis pas exempte de reproches envers ce roman historique, notamment en ce qui concerne les personnages, un peu trop tranchés à mon goût, limite des caricatures, sans aucune nuances ou alors, quand ils en ont, c’est à la grosse louche, comme Thaddeus, le bâtard qui a appris à lire, qui est intelligent, beau mec, calme, pondéré, qui ne possède pas son cerveau dans sa queue et qui, parfois, alors qu’il est paré de toutes les vertus, réagit de manière bizarre, alors qui si un autre avait fait de même, il l’aurait raillé.
Lady Anne est une sainte femme, on la canoniserait bien de son vivant : elle est intelligente, elle sait lire, est instruite, rusée, subtile, est aimée de ses serfs, leur a inculqué des idées de libertés, est à deux doigts d’inventer le socialisme (le vrai) avant l’heure, a donné des conseils sexuels aux femmes et n’hésite pas à remettre en question les dictats de l’Église.
Or nous sommes en 1348, ne l’oublions pas. L’Église a la puissance de croiseurs de combats. Les messages de lady Anne sont beaux, porteurs d’espoir, elle est humaine, réfléchie, ce qu’elle dit est vérité, mais on plonge à fond dans la caricature non réaliste vu l’époque. Elle pourrait le penser mais le dire… Oups.
A contrario, sa fille, Eleanore, est aussi bête que méchante (mais sans faire rire, comme le ferait un Joe Dalton), stupide, bornée, débile, mauvaise foi comme ce n’est pas possible de l’être (Fillon en jupons et en pire). Sans doute a t-elle trop regardé des Disney, car elle se prend pour une grande princesse, la chérie de son papounet d’amour (un débile, crétin, aviné, concupiscent, la totale) et refuse d’ouvrir les yeux quand son monde s’écroule.
On pourrait la comprendre, les certitudes et les illusions qui s’envolent, ça fait mal. Devoir ouvrir les yeux sur son avenir, qui part en couilles, demande du courage, s’inventer un monde imaginaire et accuser les autres de tous les maux peut aider à passer des caps difficiles.
Le problème est que rien ne vient atténuer son portrait et qu’elle s’enfoncera de plus en plus dans ses mensonges, dans sa réalité tronquée, alternée, dans sa haine, son mépris des autres, ses contradictions, à tel point qu’être aussi stupide n’est pas réaliste (un peroxydé blond a fait de même et c’était trèèèès lourd) car c’est le grand écart entre les deux personnages et là, trop is te veel (trop c’est trop).
On a juste envie de balancer la fille dans les douves et ensuite, après repêchage, de la foutre dans les latrines remplies et de déféquer dessus. Il y a des baffes qui se perdent, parfois.
Autant la mère est parée de toutes les vertus (un Christ au féminin) autant sa fille est parée de toutes les tares de la terre et de tous ses défauts (sauf qu’elle est bêêêlle et qu’elle le sait).
Le rythme du roman n’est pas trépidant non plus, il prend le temps de se mettre en place, sans pour autant en profiter pour éclairer le lecteur sur le côté historique (ou si peu). Nous sommes en 1348, il y a la peste, la guerre de Cent Ans, l’auteure aurait pu ancrer un peu plus son récit dans l’Histoire, nous apporter des détails, mais là, c’est assez pauvre.
Si on prenait la tension du récit, on serait dans la chute de tension totale. Votre palpitant ne risque pas grand-chose durant votre lecture.
Le récit n’offrira guère de péripéties aux lecteurs, hormis quand certains iront nous la jouer « En balade », bien que ça ressemble plus à une escapade du Club des Cinq, version enfants gâtés et pleurnichards (pendant une épidémie de peste, d’accord), qu’autre chose. Quelques moments plus intenses que d’autres, mais pas de quoi vous donner de la tachycardie. Le suspense était parti en vacances, sans aucun doute.
Puisque j’en suis à rhabiller le roman pour l’hiver, j’ajouterai qu’il manquait d’émotions, n’ayant pas réussi à me faire vibrer avec son histoire de confinement (qui se passe presque mieux que celui imposé par nos gouvernants), d’épidémie de peste, ni avec ses différents personnages trop parés de toutes les vertus, opposés à d’autres parés de tous les défauts du monde. Ils étaient trop lisses, sans aspérités, sans rien pour équilibrer les portraits.
Avec Ken Follet ou Kate Moss, ça passe, mais ici, ça coince un peu aux emmanchures.
Pourtant, malgré cette volée de bois vert que je viens de lancer sur ce roman (qui en plus possède une suite, argh !!!), je l’ai avalé en deux jours, sans sauter de pages (juste quelques lignes quand je me faisais chier).
Non pas par pur masochisme, n’exagérons pas, c’est juste que je voulais savoir comment tout cela allait se terminer (j’en suis pour mes frais, la suite au prochain épisode), si, à un moment donné, la peste de Eleanore allait ouvrir les yeux et arrêter de répandre ses bubons fielleux sur tout le monde. Et parce que, malgré ma critique sévère, je ne me suis pas trop emmerdée en lisant ce roman… Paradoxe, quand tu nous tiens.
Un roman historique qui aurait pu être un roman noir, mais qui a loupé le coche, qui aurait pu apporter un peu plus de détails sur la vie dans l’Angleterre de 1348 et qui est passé à côté de sa mission, où la Guerre de Cent Ans n’est nullement mentionnée, un roman où les personnages auraient pu être plus équilibrés, moins fades, moins caricaturés à l’extrême, mais qui a failli à ce principe là aussi.
Un roman mettant en scène la peste noire sans que cette dernière soir l’héroïne du récit, où le confinement de toute une population dans l’enceinte du château semble plus facile que ce que nous avons vécu en mars 2020 (avec nos technologies pour nous divertir)…
Sans oublier un manque flagrant de rythme, d’émotions, l’impossibilité pour le récit de vraiment prendre son envol afin d’emporter son lecteur. Le plat avait l’air super mais au final, il manquait de corps (oups) et l’équilibre des goûts n’était pas là. Dommage.
Bianca, ma copinaute de LC, a pensé la même chose que moi de cette lecture (voyez sa chronique). Nous sommes déçues de concert. La pauvre a mis plus de temps que moi à en venir à bout. Ma motivation était que, une fois celui-ci terminé, j’allais pouvoir retourner à mon « Gengis Khan – Tome 03 » qui lui était addictif à fond.
(*) Parodie de la chanson « Destinée » de Guy Marchand (merci à lui, encore une fois, car je lui emprunte souvent sa chanson).
Lu l’édition Pocket faisant 725 pages.

Challenge Thrillers et Polars de Sharon (du 11 Juillet 2020 au 11 Juillet 2021) [Lecture N°305], Le Challenge A Year in England pour les 10 ans du Mois anglais [Lecture N°58], Le Mois anglais (Juin 2021 – Season 10) chez Lou, Cryssilda et Titine et Le pavé de l’été – 2021 (Saison 10) chez Sur Mes Brizées.


 Titre : Des hommes en devenir
Titre : Des hommes en devenir  Critique :
Critique :



 Titre : Voyage au bout de l’enfance
Titre : Voyage au bout de l’enfance Critique :
Critique :
 Titre : Les Dernières heures
Titre : Les Dernières heures Critique :
Critique : 



 Critique :
Critique : 

 Critique :
Critique : 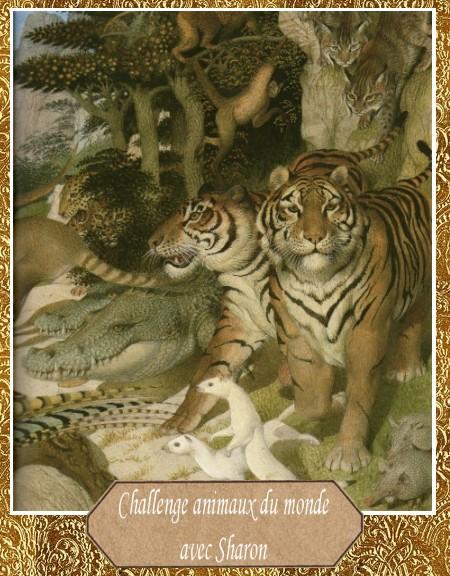

 Critique :
Critique :


 Critique :
Critique : 

 Critique :
Critique : 

 Critique :
Critique : 


 Critique :
Critique : 